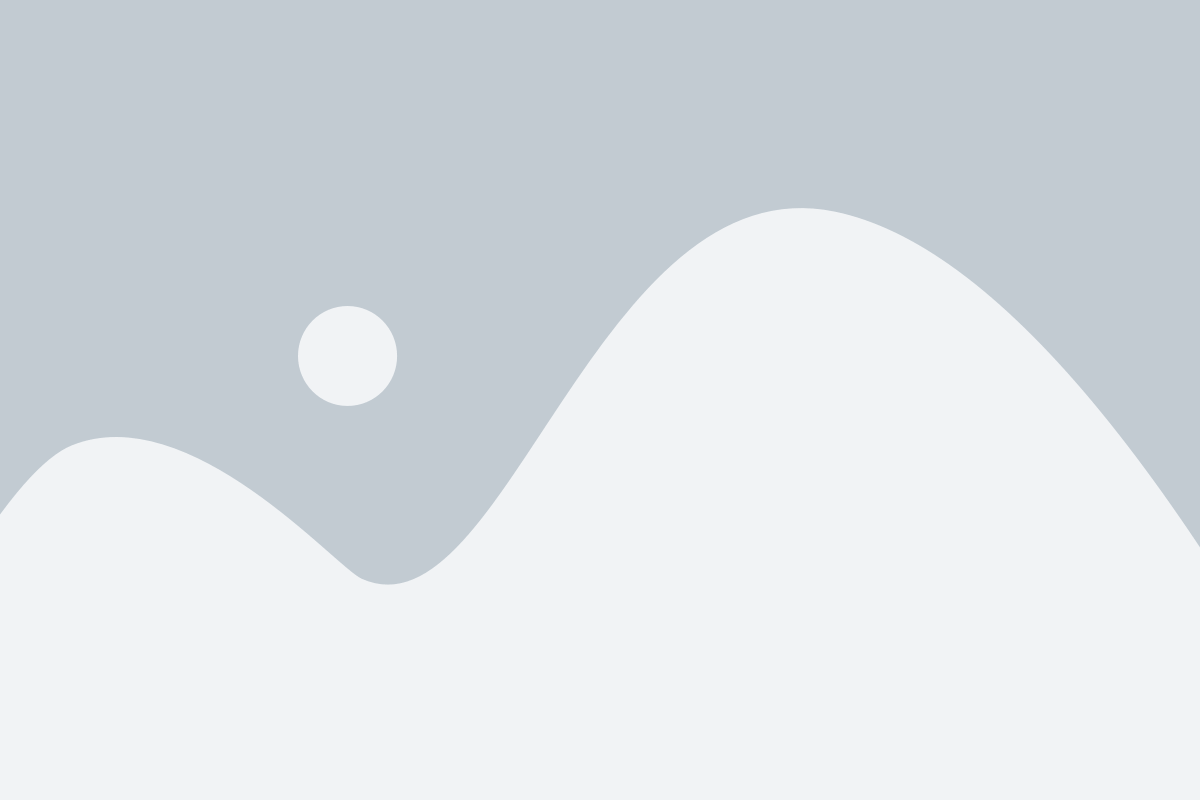
Bonjour à tous, je suis Monsieur Miguet, professeur de littérature et passionné par la poésie contemporaine. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans Le Parti pris des choses de Francis Ponge, un recueil poétique publié en 1942.
Dans cette œuvre singulière, Ponge s'attache à donner la parole aux objets du quotidien. Il adopte un point de vue original en décrivant des choses simples — comme une huître, un pain ou un cageot — avec une minutie quasi scientifique, tout en insufflant à ces descriptions une touche poétique.
Le Parti pris des choses explore la beauté cachée du banal, invitant le lecteur à redécouvrir son environnement immédiat. Par son écriture précise et imagée, Ponge rompt avec la poésie lyrique traditionnelle pour célébrer la matérialité et la texture des choses.
Francis Ponge a souvent été surnommé "le poète des objets" pour son approche unique de la poésie. Le Parti pris des choses marque un tournant dans la littérature française en plaçant les objets du quotidien au centre du discours poétique, défiant ainsi les conventions classiques.
Points clé de ce résumé sur Le Parti pris des choses
Francis Ponge, poète français du XXᵉ siècle, maître de la poésie en prose et du courant surréaliste.
Le Parti Pris des Choses
1942
Surréalisme et Poésie en prose
Le Parti Pris des Choses est publié en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans ce recueil, Francis Ponge choisit de détourner la poésie traditionnelle pour se concentrer sur les objets du quotidien. Son approche se veut une exploration minutieuse de la matière et de la langue, offrant une vision nouvelle et poétique du banal.
La célébration des objets : Ponge donne une voix aux choses simples de la vie quotidienne, comme l’huître ou le pain, en explorant leur essence et leurs caractéristiques.
La précision du langage : Le poète dissèque les mots et les objets, jouant sur les descriptions minutieuses et la poésie en prose pour créer un pont entre la matière et le langage.
La critique du lyrisme traditionnel : En s’éloignant des émotions personnelles, Ponge propose une poésie dénuée de subjectivité où l’objet est roi.
L’hommage au monde matériel : Chaque poème est un acte d’observation et de décryptage du monde physique, soulignant la beauté cachée dans la banalité.
Le Parti Pris des Choses est considéré comme l'œuvre emblématique de Francis Ponge. Sa manière unique de donner vie aux objets du quotidien a marqué un tournant dans la poésie moderne, en rompant avec les codes traditionnels et en plaçant les "choses" au cœur de l'art poétique.
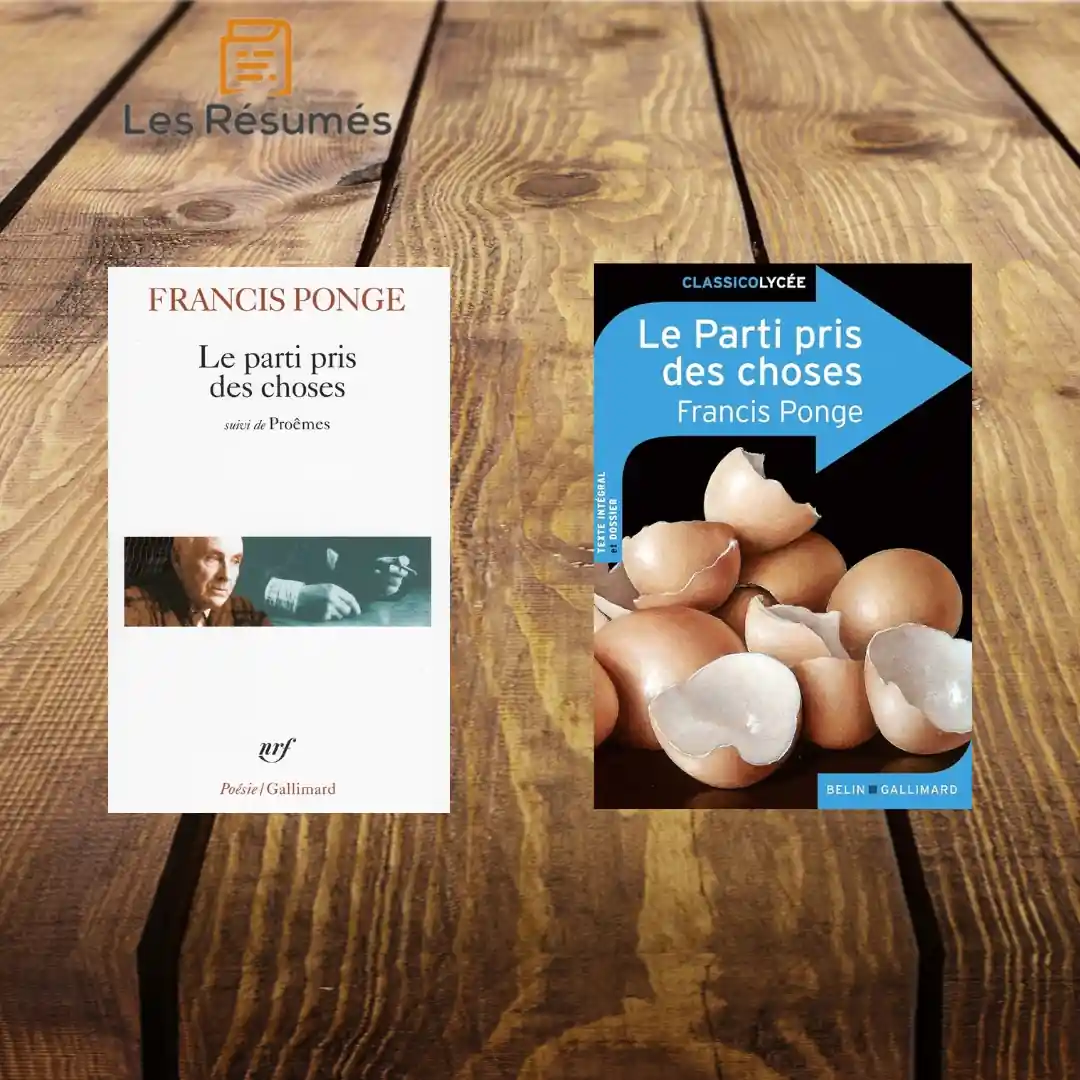
Résumé sur Le Parti Pris des Choses
Résumé court
Le Parti Pris des Choses de Francis Ponge s’apparente à un dictionnaire poétique. Chaque poème y présente la définition d’un mot, souvent un élément du quotidien. Le poète explore deux facettes de l’analyse linguistique :
- Le signifiant : à travers la sonorité du mot.
- Le signifié : les sens que renferme le mot.
Francis Ponge dissèque les objets du quotidien afin d’en livrer les caractéristiques de la manière la plus objective possible. Ces réflexions servent de base à ses « leçons de choses », qui questionnent la nature même de la poésie.
Avant de choisir "Le Parti pris des choses", Ponge avait pensé intituler son recueil "L'approbation de la nature", reflétant son désir de célébrer le monde matériel.
Les aliments comme symboles poétiques
L’œuvre se distingue par la présence récurrente des aliments. Ponge consacre plusieurs poèmes aux fruits et aux produits alimentaires :
- Les fruits aux saveurs intenses : les mûres, l’orange.
- Les mollusques et fruits de mer : l’huître, la crevette.
Ces choix révèlent l’intérêt du poète pour la diversité et la richesse sensorielle des choses simples.
Les poèmes du recueil ont été écrits principalement entre 1939 et 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle Ponge s'est engagé dans la Résistance.
La nature et les éléments
Francis Ponge accorde une attention particulière aux éléments naturels, souvent indissociables des objets qu’il décrit. Parmi ces éléments, l’état liquide est mis à l’honneur :
Cette fascination pour les éléments naturels souligne la volonté du poète de s’ancrer dans la réalité tangible et sensorielle.
En raison du contexte de l'Occupation, le recueil a été publié en 1942 par les éditions de Minuit, alors une maison d'édition clandestine.
La personnification des objets
Francis Ponge redonne vie aux objets banals grâce à la personnification. Il attribue des caractéristiques humaines aux choses inanimées :
- La cigarette est évoquée comme « sa personne ».
- Le cageot est qualifié de « sympathique ».
Le poète structure également son recueil avec soin :
- Le pain précède le feu, élément nécessaire à sa cuisson.
- La bougie et la cigarette suivent logiquement, toutes deux liées au feu.
- L’escargot est un exemple de poème à la frontière entre aliment, objet et être vivant.
Contrairement à la tradition poétique de l'époque, Ponge a choisi d'écrire ses poèmes en prose, rompant avec les formes versifiées classiques.
Des portraits humains cachés
Au-delà des objets, Ponge s'intéresse aussi à l'humanité. Certains poèmes se transforment en satire, brossant des portraits caricaturaux :
- Le stéréotype de l’employé de bureau : « R.C Seine n° ».
- Le séducteur : « Le gymnaste ».
Ces portraits soulignent la portée critique et sociale de l'œuvre, où les objets deviennent des miroirs des comportements humains.
Francis Ponge considérait ses poèmes comme des « définitions poétiques ». Il revendiquait une écriture objective qui s’éloigne des sentiments personnels pour se concentrer sur l’essence même des choses.
Liste des poèmes étudiés
Ponge utilise fréquemment un vocabulaire technique et scientifique pour décrire les objets, s'inspirant de disciplines comme la géographie ou la biologie.
Résumé par poème sur Le Parti pris des choses
Les aliments comme symboles poétiques
L’huître
- Résumé : Ce poème décrit l’huître comme un objet à la fois clos et mystérieux, passant de sa coquille rugueuse à la révélation de sa perle intérieure.
- Analyse :
- Ponge transforme l’huître en symbole de la dualité entre apparence et essence.
- La métaphore minérale (« galet ») souligne sa dureté extérieure, tandis que la perle incarne la beauté cachée.
- Le poète utilise un langage scientifique pour disséquer l’objet tout en y injectant une dimension lyrique à travers l’évocation de la lumière et de la transparence.
- Philosophiquement, Ponge interroge la relation entre le langage et la réalité : l’huître, muette, exige une description précise qui dépasse les clichés poétiques.
Le pain
- Résumé : Le pain est décrit comme une « roche fermentée », avec une croûte terrestre et une mie éphémère.
- Analyse :
- Ponge utilise une analogie géologique pour magnifier cet objet quotidien.
- La transformation alchimique (du grain à la mie) symbolise le cycle de la vie et de la mort.
- Le pain devient un microcosme de l’univers, où la croûte représente la matière brute et la mie l’évanescence.
- Stylistiquement, les allitérations (« masse mal cuite ») imitent la densité de la pâte.
Les mûres
- Résumé : Ces fruits amers et difficiles d’accès symbolisent la lutte poétique.
- Analyse :
- Les mûres incarnent la beauté rude et l’effort créatif.
- Ponge les décrit comme des « boules d’encre », métaphore de l’écriture elle-même, à la fois âpre et riche.
- Le lexique botanique se mêle à une réflexion métapoétique : cueillir les mûres équivaut à extraire le sens des mots.
L’orange
- Résumé : Ce fruit est décrit comme un « globe de nectar » passif, offert au sacrifice.
- Analyse :
- L’orange devient une allégorie de la poésie traditionnelle, jugée trop docile.
- Ponge lui oppose une écriture révoltée, symbolisée par le citron.
- Les antithèses (« douceur passive » vs. « âpreté active ») illustrent ce conflit esthétique.
Le mollusque
- Résumé : Le mollusque est dépeint comme une essence pure, protégée par sa coquille.
- Analyse :
- Ponge utilise un vocabulaire philosophique (« quintessence ») pour évoquer son intériorité.
- La coquille symbolise à la fois protection et isolement, reflétant la tension entre expression et retenue en poésie.
- Le mollusque incarne l’idéal d’objectivité pongien, purifié de tout lyrisme.
La crevette
- Résumé : Ce crustacé est décrit dans sa dynamique aquatique, entre fluidité et rigidité.
- Analyse :
- Par des métaphores géométriques (« virgule vivante »), Ponge capture son mouvement.
- La crevette symbolise l’adaptation, survivant dans un milieu hostile.
- Philosophiquement, elle illustre l’équilibre entre forme et fonction.
Francis Ponge utilisait la description minutieuse des objets pour explorer les liens entre le langage et la réalité. Ses poèmes transcendent la simple description pour devenir de véritables réflexions philosophiques et poétiques.

La nature et les éléments
Le galet
- Résumé : Ce poème explore la résistance silencieuse du galet, poli par la mer mais inchangé dans son essence.
- Analyse :
- Ponge célèbre l’opacité et la persistance de la pierre, opposée à la fluidité de l’eau.
- Le lexique géomorphologique (« érosion », « stratification ») se mêle à une méditation sur le temps.
- Le galet incarne l’idéal pongien : un objet qui résiste à l’interprétation et défie le lyrisme traditionnel.
Le feu
- Résumé : Le feu est dépeint comme une « singerie du soleil », à la fois créateur et destructeur.
- Analyse :
- Ponge emploie des métaphores mythologiques pour interroger l’ambivalence du feu.
- L’oxymore (« grimaçante splendeur ») souligne sa dangerosité séduisante.
- Le feu devient un symbole de l’hubris humain, illustrant la tentative de rivaliser avec la nature tout en restant éphémère.
La pluie
- Résumé : Une description mécaniste de la pluie, comparée à une horloge liquide.
- Analyse :
- Ponge utilise des métaphores horlogères (« rouage », « ressort ») pour représenter son cycle infini.
- La synesthésie (« concert sans monotonie ») traduit la musicalité de la pluie.
- Ce poème reflète une vision déterministe de la nature, opposant l’ordre naturel au désordre humain.
Le pré
- Résumé : Un champ herbeux devient le lieu d’une méditation sur la croissance et la résistance.
- Analyse :
- Ponge développe une poétique de l’horizontalité, opposée aux verticalités humaines.
- Le pré symbolise la résilience naturelle, survivant aux piétinements.
- Les enjambements stylistiques miment l’expansion continue des herbes.
Le papillon
- Résumé : Métamorphose d’une « allumette volante » éphémère en symbole de légèreté.
- Analyse :
- Le papillon incarne la fragilité poétique, brillante mais évanescente.
- Ponge utilise des métaphores lumineuses (« flamme ») pour souligner sa grâce éphémère.
- Ce poème questionne la possibilité d’une beauté durable.
L’araignée
- Résumé : Prédateure méthodique, l’araignée tisse sa toile comme un piège philosophique.
- Analyse :
- Ponge emploie des métaphores textuelles (« toile d’idées ») pour associer l’araignée à la création artistique.
- La toile symbolise à la fois l’ordre et l’illusion, soulignant les pièges du langage.
- Le poème interroge la frontière entre art et prédation.
Le verre d’eau
- Résumé : Une méditation sur la transparence et la simplicité.
- Analyse :
- Ponge célèbre l’eau comme une essence pure, opposée aux complications humaines.
- Les oxymores (« lourd de légèreté ») soulignent son paradoxe fondamental.
- Le poème défend une esthétique de la sobriété, où le banal devient sublime.
Le cycle des saisons
- Résumé : Les saisons défilent comme une métaphore des répétitions poétiques.
- Analyse :
- Ponge dénonce la stérilité des conventions littéraires, comparées à un cycle naturel sans surprise.
- Les images végétales (« bourgeons verbaux ») illustrent une poésie engluée dans le cliché.
- Ce poème plaide pour une rupture créatrice, en quête de renouveau hors des sentiers battus.
Francis Ponge considérait ses poèmes comme des objets littéraires, à mi-chemin entre description scientifique et réflexion poétique. Il cherchait à révéler l’essence cachée des choses les plus banales.

La personnification des objets
Le cageot
- Résumé : Objet éphémère destiné à être brisé après usage, le cageot est décrit dans son utilité fragile et sa fin tragique à la voirie.
- Analyse :
- Ponge érige ce déchet en allégorie de la condition humaine, éphémère et vouée à l’oubli.
- Les oxymores (« chef-d’œuvre de simplicité ») et le rythme saccadé imitent la décomposition de l’objet.
- Le cageot devient un manifeste contre le gaspillage, critiquant la société consumériste.
- Stylistiquement, Ponge emploie un lexique technique (« claire-voie », « agencement ») pour célébrer l’humble.
La bougie
- Résumé : La bougie est peinte comme une entité paradoxale, à la fois fragile et résistante, éclairant l’obscurité tout en se consumant.
- Analyse :
- Par des métaphores alchimiques (« colonnette d’albâtre »), Ponge sublime l’éphémère.
- La personnification (« lutte contre l’ombre ») transforme la bougie en symbole de la connaissance et du sacrifice.
- Philosophiquement, la bougie incarne l’ambiguïté de la création : sa lumière révèle les objets tout en les déformant, reflétant les limites du langage poétique.
La cigarette
- Résumé : La cigarette est décrite comme une « allumette volante », éphémère et paradoxale.
- Analyse :
- Ponge juxtapose des images organiques (« torche ») et un lexique chimique (« combustion ») pour capturer sa dualité.
- La cigarette devient une métaphore de la pensée : brillante mais fugace, libératrice mais destructrice.
- Le poème critique subtilement les illusions de la modernité, où le progrès se consume lui-même.
Le savon
- Résumé : Objet hygiénique transformé en allégorie de la purification linguistique.
- Analyse :
- Le savon devient une métaphore de l’écriture, lavant les mots de leurs clichés.
- Ponge mêle lexique chimique (« saponification ») et images morales (« pureté »), critiquant les impuretés du langage poétique conventionnel.
La porte
- Résumé : Objet banal transformé en symbole de transition et de possibles.
- Analyse :
- La porte incarne le seuil entre réel et imaginaire.
- Ponge décrit son « corps à corps » avec l’homme, mêlant personnification et mécanismes sonores (grincements).
- Philosophiquement, la porte symbolise l’hésitation créatrice, entre ouverture et fermeture.
Le gymnase
- Résumé : Lieu de performance physique, miroir des vanités humaines.
- Analyse :
- Ponge critique l’obsession du paraître, opposant la musculature artificielle à la profondeur des objets.
- Le gymnase symbolise une société du spectacle, où la forme prime sur le fond.
Francis Ponge, à travers ses poèmes, s’applique à redonner une nouvelle dignité aux objets du quotidien, transformant l’humble et l’éphémère en sources poétiques d’inspiration. Son travail est un véritable manifeste pour une poésie des choses.

Des portraits humains cachés
Le gymnaste
- Résumé : Un portrait grotesque d’un athlète vaniteux, réduit à sa musculature.
- Analyse :
- Par des comparaisons animales (« singe », « chenille »), Ponge déshumanise le gymnaste, critiquant le culte du corps.
- La lettre « G » structure le poème, accentuant la superficialité du personnage.
- Ce texte est une satire de la performance, opposée à la profondeur des choses.
Le Parti Pris des Choses révolutionne la poésie en faisant des objets banaux des sujets philosophiques. Par un mélange de précision scientifique et de lyrisme contrôlé, Ponge défie les conventions, célébrant l’opacité et la résistance du réel. Chaque poème est un manifeste pour une langue renouvelée, capable de révéler l’essence des choses sans les trahir.

Analyse littéraire sur
Le Parti Pris des Choses
Le Parti Pris des Choses constitue une œuvre majeure du vingtième siècle. Le recueil s’articule autour de cinq thématiques principales, à savoir : une attention particulière au détail, la restitution des liens entre le poème et le monde, le rejet d’un monde centré sur l’homme, le rejet du lyrisme, et une réflexion sur la poésie.
Les Principaux thèmes évoqués dans Le Parti pris des choses
Le travail de Francis Ponge s’illustre par son soin du détail. La fascination qu’exerce sur lui l’objet de ses écrits se traduit par sa méticulosité et son attention particulière au moindre détail. Qu’il s’agisse de la forme globale, évidente, ou bien des plus petits détails, quasiment imperceptibles, des « choses », l’écrivain ne manque pas de les remarquer puis d’attirer vers eux l’attention des lecteurs. Le style d’écriture du poète ambitionne de faire office de loupe. Il cherche à offrir une vision panoramique des choses d’un côté ; et en révéler des détails intrinsèques ainsi que les fonctions intimes, de l’autre côté.
La restitution des liens entre le poème et le monde
Francis Ponge est un amoureux de la nature. Son œuvre rappelle fortement les poèmes antiques cosmiques, centrés sur la nature. Dans sa vision, le poème sert à mettre des mots sur la nature, qui représente un texte en soi. En un sens, le poète se veut porte-parole de la nature. Bien que sa démarche se veuille objective, Francis Ponge revalorise et ajoute un soupçon de magie au monde à travers diverses personnifications. De plus, ses descriptions comportent un aspect affectif flagrant : il évoque des marques d’affection envers une « chose », témoigne d’une certaine envie de fusionner avec la nature, ou encore décèle des sensualités insoupçonnées dans les objets de ses écrits.
Le rejet d’un monde centré l’homme
Francis Ponge rejette les normes de la poésie du vingtième siècle qu’il juge focalisée à outrance sur l’homme et ses sentiments. Le titre Le Parti Pris des Choses témoigne d’ailleurs de son positionnement à l’opposé de cette tendance. Fortement influencé par le contexte d’entre-deux guerres des années quarante, le poète argumente en faveur de la mise en retrait de l’homme. En effet, il condamne les penchants de l’humanité pour la démesure.
Le rejet du lyrisme
Le poète se lance dans une démarche apoétique, marquée par le rejet du lyrisme traditionnel. Par exemple, il ridiculise ouvertement un des thèmes de prédilection du lyrisme, « l’automne ». Il devient alors possible de conclure que les « définitions » de l’auteur comportent deux facettes. D’une part, elles revalorisent les objets prosaïques et les font connaître du public sous un nouveau jour ; d’autre part, il dépouille de certains objets le lyrisme et la poésie dont ils sont normalement entourés.
Les poèmes de Francis Ponge cherchent à brosser le plus complet des portraits. Ainsi, il n’hésite pas à révéler crûment la laideur qui se cache derrière des objets anodins, comme le sang versé derrière chaque morceau de viande. De plus, il n’oublie pas de mentionner la force de destruction que possède la nature. Force qu’il craint et respecte puisqu’il la place au-dessus de la poésie en elle-même.
Le Parti pris des choses, une réflexion sur la poésie ?
Le Parti pris des choses apparaît comme la description d’objets prosaïques. Néanmoins, derrière ces définitions se cache une réflexion poussée sur la poésie. À force d’efforts et de réflexions, il est possible d’accéder à de nouvelles compréhensions sur le domaine de l’art poétique. En d’autres termes, ce texte apoétique renferme un charme poétique décelable après un certain travail.
En mettant l'accent sur les choses plutôt que sur les émotions humaines, Ponge propose une vision du monde où les objets sont au centre de l'attention poétique.

Les caractéristiques de l'écriture de Francis Ponge dans Le Parti pris des choses
Une écriture en faveur de l’ « objectivité »
Dans Le Parti pris des choses, l’auteur met au service de la littérature la démarche scientifique. Il analyse méticuleusement chaque objet et met en évidence ses particularités. Afin de maintenir le sentiment d’objectivité, il multiplie l’emploi des articles définis et favorise l’utilisation du présent de vérité générale. Cependant, il serait une erreur de penser que sa démarche scientifique se traduit par une écriture dénuée de lyrisme. En effet, le poète met à contribution les vertus des mots pour ajouter de la poésie à ses descriptions « objectives ».
Une écriture mettant l’accent sur l’étymologie
Dans la poésie lyrique du vingtième siècle, les poètes ont plus tendance à jouer sur les connotations des mots. Francis Ponge se démarque de ses pairs par son intérêt pour l’étymologie des mots. En faisant appel au sens étymologique, le poète fait émerger des polysémies qui ouvrent sur des métaphores inattendues. Cette approche entoure les textes de l’auteur d’un halo lyrique différent.
Une écriture mettant l’accent sur l’étymologie
Le Parti pris des choses apparaît comme la description d’objets prosaïques. Néanmoins, derrière ces définitions se cache une réflexion poussée sur la poésie. À force d’efforts et de réflexions, il est possible d’accéder à de nouvelles compréhensions sur le domaine de l’art poétique. En d’autres termes, ce texte apoétique renferme un charme poétique décelable après un certain travail.
Une écriture comique et spirituelle
Le Parti pris des choses est également considéré comme une poésie comique et spirituelle. En effet, le poète redonne la parole au monde à travers des jeux de sonorités. Par exemple, il juxtapose des paronymes (mots aux sonorités similaires) et des onomatopées pour imiter le langage de la nature. Cette démarche dénote d’une certaine spiritualité. De plus, il démontre un talent pour le néologisme en vue de lier langage et réalité (C.F. « amphibiguité »). Il se sert également des outils de la poésie normée, telles que la rime, afin d’accentuer l’effet comique qu’il désire donner à son texte. Par exemple, dans « tous les cœurs il dévaste mais se doit d’être chaste et son juron est BASTE ! ».
Son travail met l'accent sur la matérialité des choses, s'opposant à une poésie trop abstraite ou métaphysique.

Redonner de la valeur aux objets : L'art de Francis Ponge
Dans Le Parti pris des choses, Francis Ponge cherche à redonner aux objets du quotidien leur réelle valeur. Il utilise de nombreuses images, obtenues à travers des métaphores et des comparaisons inattendues, pour restituer l’originalité des « choses ». Il ôte la composante lyrique de certains objets afin de révéler leurs autres vertus, plus prosaïques, comme c’est le cas pour la fleur. Ponge surprend les lecteurs grâce à ses images peu orthodoxes, fruits de son érudition lexicale, afin d’offrir une nouvelle perception de la réalité.
Élargir les perceptions usuelles
Tantôt éloignés des expressions idiomatiques stéréotypées, tantôt pourvus d’un lyrisme certain, les poèmes de Ponge élargissent les horizons du lecteur en le libérant des contraintes des perceptions usuelles.
Exemple :
- Pour Ponge, « le papillon » est à la fois « une tasse mal lavée » et « un minuscule voilier des airs malmené par le vent ».
L’auteur pose ainsi de nouveaux repères poétiques. Il met à profit ses connaissances linguistiques pour créer une poésie paradoxale :
- Poésie des objets de consommation
- Poésie de la nature, avec une vision terre-à-terre
La particularité de Ponge réside dans sa capacité à arracher les objets de leur prose aux stéréotypes habituels. Le titre du recueil indique clairement son engagement : il prend le parti, non de l’humanité, mais des « choses ».
Le pouvoir du néologisme
Le recours au néologisme est une marque distinctive de l’œuvre de Ponge. Ce procédé, souvent basé sur la contraction de deux mots, enrichit sa poésie tout en ajoutant une touche comique. Exemple :
- « Objeu » (contraction de « objet » et « jeu »)
Grâce à ces néologismes, Ponge :
- S’affranchit des chaînes du langage
- Introduit un effet comique dans ses descriptions scientifiques
Une Œuvre paradoxale
L’œuvre de Francis Ponge se révèle profondément paradoxale :
- Objectivité : Le poète se focalise sur les qualités des objets, ignorant les perceptions subjectives héritées du collectif.
- Subjectivité : En décomposant méticuleusement la réalité, Ponge impose malgré tout sa propre vision poétique.
Ce paradoxe donne naissance à une nouvelle expression poétique : un lyrisme impersonnel qui reste toutefois profondément personnel.
Ponge entretenait des relations étroites avec des peintres comme Picasso et Braque, et son écriture reflète une sensibilité picturale dans la description des objets.

Fiche de synthèse de ce résumé sur Le Parti pris des Choses
- Auteur : Francis Ponge
- Titre : Le Parti Pris des Choses
- Date de publication : 1942
- Contexte :
- Publié pendant l’Occupation, l’ouvrage marque une rupture avec la poésie lyrique et engagée de l’époque.
- Ponge développe une approche nouvelle du langage en mettant en avant le monde des objets et des choses du quotidien.
- Courant littéraire : Poésie en prose, influence du surréalisme et de l’objectivisme
- Thématiques principales :
- La description minutieuse des objets
- La matérialité du monde
- Le langage et sa relation aux choses
Le Parti Pris des Choses est un recueil de poèmes en prose où Francis Ponge donne la parole aux objets les plus banals : le pain, l’huître, le cageot… Il adopte un regard quasi scientifique et poétique pour explorer leur essence, leur forme, leur texture et leur signification. Loin du lyrisme traditionnel, son écriture met en avant la matérialité brute et célèbre les objets à travers un langage précis et inventif.
- La réhabilitation des objets ordinaires : Une observation minutieuse du monde matériel.
- Le langage comme outil de création : Ponge joue avec les mots pour révéler les choses autrement.
- Le refus du lyrisme : Une poésie descriptive et objective, éloignée de l’émotion personnelle.
- L’homme face aux objets : Une réflexion sur notre rapport au monde matériel.
Vous avez aimé cet article ? Notez-le !
5 (3)
Aucun vote, soyez le premier !








Ce résumé du “parti pris des choses” de Francis Ponge est très complet, il décortique bien cette oeuvre qui est, à mon avis, assez complexe. Seulement, une idée me traverse l’esprit. En effet, le sujet d’un probable mal-être lui faisant chercher un idéal dans le monde “banal” dans lequel il vit peut sûrement aussi être réfléchi, mais ce n’est qu’une suggestion de ma part, très bon résumé autrement.